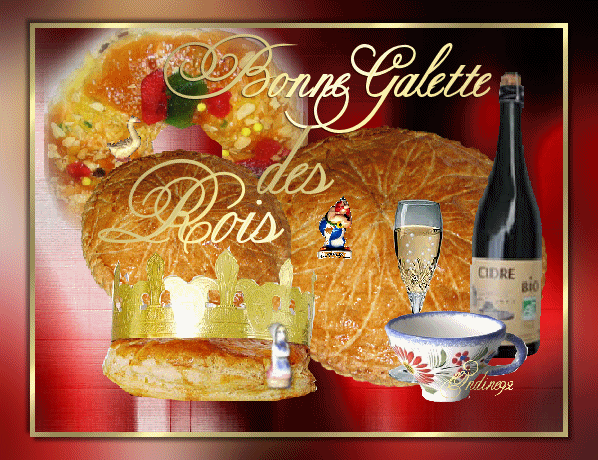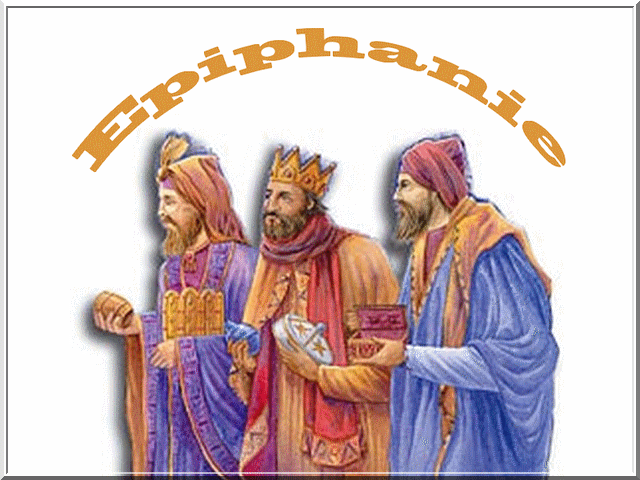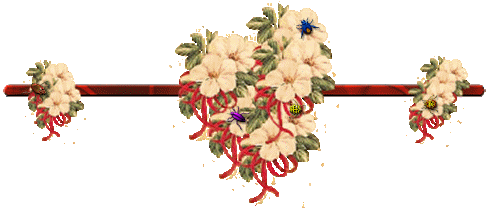|
|
[ *** -Méli - Mélo du Jour & Humour ***- ] [ -***PageAccueil § Bienvenue & Welcome & Bienvenido - Bienvenue -- Tous Pays & Tous sujets divers ***- ] [ -*** Spiritualité - Religions et Divers avis ***- ] [ -*** Belles images ***- ] [ -*** Infos. -- Docs § Vidéos ***- ] [ -***Photos - Découverte de divers lieux ***- ] [ ***- Musique - Chansons & Cinéma *** ] [ -***Origines et Coutumes : Toutes fêtes Religieuses ou non ***- ] [ -***Mes passions - Créas, Peinture/Dessin & Diapos ***- ] [ -***& Citations § Poésies § Beaux Textes & Musique ***- ] [ -***Zen - Modes de vie et divers conseils ***- ] [ -*** Animaux & Flore - Environnement § Défense Animaux - Faune ***- ]
|
|
|
|
* Ethymologie - Origines / Ville de Montpellier & Images , photos anciennes § Photos plus+ actuelles § A bientôt, pour un prochain Article, des origines de Montpellier, découvertes, l
27/01/2016 15:05

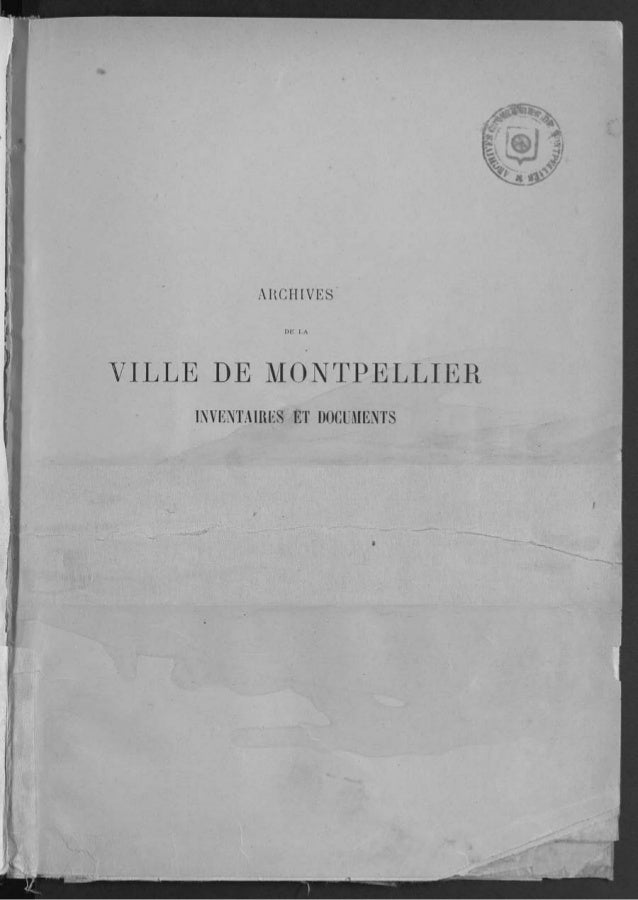
 L’étymologie du nom de Montpellier est très discutée : on hésite entre Mons Pessulus (la montagne fermée par un verrou), ce qui ferait allusion des palissades qui auraient entouré la ville ; ou bien Mons Pistillarius (mont des épices: comment on ne devait trouver des masses de thym ou de serpolet cultivés, probablement comprendre le mont des épiciers); ou encore Mons Puellarum (le mont des pucelles!) On a même pensé à « mons pestelarius » : mont du pastel! (une histoire de couleurs!?) Les étymologistes (parfois supposés tels) trouvent souvent beaucoup d’hypothèses pour des noms de lieux, surtout quand on n’est pas sûr de l’étymologie ou de l’histoire (anecdotes, écrits, récits, détails archéologiques).L’étymologie la plus vraisemblable est « mons petrosus » en latin, devenu en vieux-français Monpeirié (la montagne – en fait colline- de « peire », à savoir de pierre) Donc ni mon (possessif) pellier. Ni mont ..pelé. Et encore moins une histoire de pelles, au cas où… L’étymologie du nom de Montpellier est très discutée : on hésite entre Mons Pessulus (la montagne fermée par un verrou), ce qui ferait allusion des palissades qui auraient entouré la ville ; ou bien Mons Pistillarius (mont des épices: comment on ne devait trouver des masses de thym ou de serpolet cultivés, probablement comprendre le mont des épiciers); ou encore Mons Puellarum (le mont des pucelles!) On a même pensé à « mons pestelarius » : mont du pastel! (une histoire de couleurs!?) Les étymologistes (parfois supposés tels) trouvent souvent beaucoup d’hypothèses pour des noms de lieux, surtout quand on n’est pas sûr de l’étymologie ou de l’histoire (anecdotes, écrits, récits, détails archéologiques).L’étymologie la plus vraisemblable est « mons petrosus » en latin, devenu en vieux-français Monpeirié (la montagne – en fait colline- de « peire », à savoir de pierre) Donc ni mon (possessif) pellier. Ni mont ..pelé. Et encore moins une histoire de pelles, au cas où…

1.D’ailleurs, le mot latin « mons » ne signifie pas « mont-agne » mais colline, sens latin originel. Si vous y êtes allés, les Montpellier, Montastrucq, Montesquieu, Montségur, etc…n’ont rien d’une véritable montagne, mais souvent d’une colline, c’est vrai souvent rocheuse, donc un peu exagérée en « montagne ». (Si Mont…de Marsan était une montagne, çà se saurait dans les Landes!)
2.Il faut chercher la cohérence du mot, même en étymologie. Que signifierait le « mont des épices »? Un marché renommé? Il faut en trouver les traces. Ici, à la limite. Mais « le mont des pucelles », même si c’était un fantasme très répandu au 13è siècle (comme les sorcières!), il faudrait que quelqu’un nous dise quel était cet endroit où l’on emmenait les vierges! Ce n’est pas une raison pour jeter…la pierre à tous les gens qui ont fait ces hypothèses.
Fait rare dans l’Histoire: Montpellier va changer de nom 14 fois (!) entre l’an mil et l’époque d’Henri IV, donc en cinq siècles grosso-modo. Parfois tous les 10 ans (aux 11è et 12è siècles) passant de Monspetellarius à Monpessulus, puis Monspeylier, pour se stabiliser vers 1495. Et encore, on reste dans des mots à peu près semblables; mais que dire quand on passe de Lutèce à …Paris!
Voilà donc, en résumé, l’évolution du mot en quelques étapes simplifiées :
Mont-peirié > Mont-perié > Mont-perrié (l’idée de pierre apparait mieux, un peu comme si on disait « mont-pierreux ») > Mont-pellié (le « r » devient plus « liquide » et se transforme en « l ») > Montpellier.
(Question subsidiaire: doit-on dire « Montpéllier » ou « Montpeullier »? Vaste et douloureux débat parigo-languedocien! Linguistiquement parlant, devant les deux L, le e doit se dire é…)
BONUS : Un mot sur le Golfe du Lion (forcément). (golfe de Gascogne, golfe du Morbihan, de Gênes, on comprend…) Que vient faire ce fauve sur les rives de la Grande-Motte?
On dit qu’à l’époque du Moyen-Age les marins qui naviguaient en Méditerranée se déplaçaient en repérant des points visibles le long de la côte. En l’occurrence, souvent, la presqu’ile (volcanique) de Maguelone, reliée à Villeneuve par un banc de sable, et dont le rocher avait la forme d’un sphinx, c’est-à-dire un…lion couché à tête d’homme! De loin (et même parfois de près) les marins certifiaient avoir vu un véritable lion (cf. dans l’ »Odyssée » les compagnons d’Ulysse et les sirènes-lamantins) Dernière curiosité: Aujourd’hui, on se repèrerait plutôt au Pic…St Loup! (en face du Mont d’Hortus, appellation contrôlée des Coteaux du Languedoc). Mais finalement, d’un animal effrayant à l’autre…
Les origines de Montpellier
Par Thierry Arcaix, samedi 5 janvier 2008 à 11:38 :: General :: #12 :: rss
C’est en 985 qu’apparaît pour la première fois le nom Montpellier...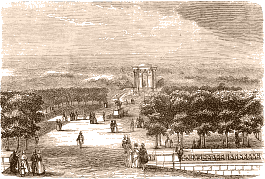
Un siècle plus tard, c’est une ville qui est ainsi désignée. En 1204, le roi d’Aragon en devient le seigneur. Par le savoir de ses médecins et de ses juristes, par le travail de ses artisans et la richesse de son commerce, la ville va s’imposer de l’Italie à l’Espagne. Une naissance obscure et tardive et une croissance exceptionnelle résument la double originalité de notre capitale régionale.
Avant Montpellier donc, l’érosion a modelé trois collines : à l’Ouest, le Peyrou, qui culmine à 52 mètres ; au centre Montpellier séparé du Peyrou par un val aujourd’hui enjambé par le pont qui précède l’arc de triomphe et à l’est Montpelliéret, séparé moins nettement de Montpellier par une ligne qui irait du Pila Sain-Gély (vers la rue de l’Aiguillerie) jusqu’à la rue de la Saunerie.
Le 26 novembre 985, le comte Bernard et Sénégonde, son épouse, donnent à Guilhem, en échange de son service et de son dévouement, deux manses (parcelles) l’un à Candillarges, l’autre à Montpellier, Mont Pestelerio, qui sera écrit en langue romaine Montpestler et en latin, Monspessulanus. Mais son étymologie a suscité plusieurs hypothèses. La plus populaire fait de Montpellier le mont des jeunes filles (mons puellarum). Elle est aussi fantaisiste que mont des poissons ou des épiciers. Pour d’autres, Montpellier est le mont du verrou (mons pessulus) à cause de l’enceinte qui ferme la ville ou du mont qui barre la route. Certains y ont vu le mont des pierres (mons peirie). Enfin, Montpellier serait le mont du pastel (mons pestellerius). Des études récentes ont abouti à des résultats divergents. Ch. Camproux trouve l’origine de Montpellier dans l’indo-européen pela, la colline. J.-P. Chambon trouve dans ce nom la trace d’une activité de forgeron, F.R. Hamlin le mont ou on cultive des petits pois (du latin pisulum)…
En 985, Monte Pestellario désigne une villa aux contours inconnu dans lequel un manse, un terroir agricole, est donné à Guilhem. Un seul habitant, Amalbert, est nommé. Sa famille est probable et indéterminée. Amalbert est le premier Montpelliérain connu. Aucun texte, aucun indice archéologique ne permettent de croire à une agglomération ou un sanctuaire préexistant.
En 985, le nom émerge pour la première fois, accroché à une terre. Les Guilhems et le hommes qu’ils ont attiré en feront le nom d’une grande ville. De l’agglomération à ses débuts nous ne savons rien. Pourtant, le seigneur et les hommes de Montpellier ont pu, aux environs de 1080, empiéter sur les droits du comte de Melgueil, qui se plaindra d’usurpation sur ses biens et sur ses droits en terme d’adultère, de rapt, de monnaie ou de poids. Il finit par de larges concessions et promet, moyennant finances, sa fille au seigneur de Montpellier. A la fin du onzième siècle, une rivalité entre Guilhem V et le viguier (juge) aboutira à la séparation de Montpellier et de Montpelliéret, chacun sur sa petite colline.
La suite : Histoire de Montpellier, sous la direction de Gérard Cholvy, aux éditions Privat.
http://www.thierryarcaix.com/blog/index.php/
 

 


Quelques photos de Montpellier / Actuel .

| |
|
|
|
|
|
|
|
* La Chandeleur, les crêpes / Origine, histoire & Images,photos & On y est pas encore, mais ça ira vite; et, ce sera un bon moment & "bonne Chandeleur , et crêpes&
24/01/2016 14:49


Date de la Chandeleur
La date de la Chandeleur.

|
Fête |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Chandeleur |
Mardi 2 Février |
Jeudi 2 Février |
Vendredi 2 Février |

 Fête de la chandeleur : quand la religion rencontre les croyances populaires Fête de la chandeleur : quand la religion rencontre les croyances populaires
Aujourd'hui attachée à la religion catholique, la fête de la chandeleur est très probablement d'origine païenne. La date de la chandeleur, début février, coïncide pour le monde paysan avec la sortie de l'hiver, la renaissance de la nature et les premières semailles. Celtes et Romains pour ne citer qu'eux honoraient déjà, à des moments très proches de l'actuelle date de la chandeleur, leurs dieux et déesses de la fertilité.
La Chandeleur devient une fête catholique
La fête de la chandeleur correspond pour la religion catholique à la présentation de l'enfant Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance. Des processions se forment pour l'occasion, les pèlerins portant alors des cierges, probable héritage des torches que brandissaient les paysans en guise de symbole solaire. À cette "fête des chandelles", s'ajoute la tradition de la confection de crêpes. Il semblerait également que cette tradition si prisées des enfants ait une double origine : les paysannes confectionnaient ces galettes pour attirer la prospérité vers leur foyer, tandis que les pèlerins les recevaient en récompense à leur arrivée à Rome, sur décision dit-on du pape Gélase 1er au Vème siècle.
La date de la Chandeleur est donc pour noter calendrier le 2 février. Il sera alors temps d'attraper les saladiers, mélanger lait et farine, ajouter les œufs, le beurre et une petite pointe de sel avant de faire virevolter les poêles ! Que le doux grésillement du beurre soit dans chaque maison le signal du début de la fête. Les croyances populaires voulaient que l'on serre un Louis d'or dans la main gauche en faisant sauter la première crêpe, ou que celle-ci vole au-dessus de l'armoire pour porter bonheur ! À bon entendeur ! Et quelles que soient vos croyances, bonne chandeleur 2016 à tous !
Tradition des crèpes pour la Chandeleur, pourquoi ?
Une explication tend à dire que la forme ronde et la couleur des crèpes rappellent celle du soleil, ce qui concorde avec le début de l'allongement des journées. Aussi, cette pèriode coïncide avec la période des semailles d'hiver, l'excédent de farine servait à la confection des crèpes. Les crèpes deviendront alors le symbole de cette fête familiale.
 
 La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 février. Vous pouvez aussi consulter la date du Mardi-Gras. La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 février. Vous pouvez aussi consulter la date du Mardi-Gras.
Origine et signification de la Chandeleur

La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles », lui-même traduit du latin festa candelarum. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que « Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la vierge Marie.
En effet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, la tradition juive voulant que chaque premier-né mâle de la famille soit amené au Temple 40 jours après sa naissance afin d'être consacré au seigneur. Cette durée de 40 jours correspond à la période durant laquelle les mères étaient considérées comme impures par la loi juive après leur accouchement, interdiction leur était donc faite de se rendre sur un lieu de culte. Une fois ce délai écoulé, les mères pouvaient se rendre au temple afin d'y effectuer un sacrifice animal et recouvrer ainsi leur pureté1.
Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au Temple, l'évangile de Luc raconte qu'un homme nommé Siméon y vint, poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il y prit Jésus dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple »2.
C'est donc cet événement religieux précis que les fidèles se remémorent lors de la Chandeleur. Toutefois, il semble que cette fête ait des origines plus anciennes, et pourrait être la reprise d'un rite romain, les amburbiales, lié à la purification de la ville. Rite célébré par des processions au flambeau autour de Rome3. La christianisation de ce rite païen serait l'oeuvre du pape Gélase 1er (en 494) ou de l'empereur Justinien (dans un édit de 542), les sources divergeant à ce sujet.
Célébration de la Chandeleur
Dans la religion catholique, la Chandeleur donne lieu à une bénédiction des cierges, puis à une procession aux chandelles jusqu'à l'église où a lieu une messe solennelle, cela afin de rappeler aux fidèles la montée de Joseph et Marie, portant Jésus au Temple. À l'issue de cette messe, chaque fidèle rapporte chez lui un cierge auquel on prête des vertus purificatrices selon les traditions locales ou nationales.
La Chandeleur dans la culture populaire : les crêpes

Aujourd'hui, comme Mardi Gras, cette fête est associée aux crêpes que l'on cuisine à cette occasion. Tradition que l'on fait remonter à la coutume de distribuer des galettes aux pèlerins venant à Rome4, ou plus simplement, pour se rappeler que la fin de l'hiver approche et que l'on a encore des réserves de nourriture. Cette pratique associant fête des Lumières à la consommation d'un dessert « gras » se retrouve aussi dans la tradition juive qui consiste à manger des beignets lors de la fête de Hanoucca (fête des Lumières du judaïsme)5.
De plus, lorsqu'on cuisine la première crêpe, il est courant de la faire sauter plusieurs fois de suite afin de conjurer le mauvais sort pour l'année à venir. Une vieille tradition rapporte que les paysans avaient coutume de le faire en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche (un louis d'or pour les plus riches) afin d'attirer sur eux bonheur et prospérité...6
La Chandeleur dans le monde
-
Au Luxembourg, la tradition actuelle hérite de la procession aux flambeaux, car actuellement, les enfants parcourent en groupes les rues pendant la soirée du 2 février en tenant un lampion ou une baguette. Ils chantent des chansons traditionnelles en espérant recevoir des sucreries en échange.
-
Au Mexique, la Chandeleur est un jour férié, mais aussi l'occasion de manger des tamales, des papillotes à base de farine de maïs qui peuvent être salées ou sucrées et fourrées avec de la viande ou des fruits.
-
De plus, aux États-Unis et au Canada, on associe à la date du 2 février une autre fête, le « jour de la marmotte » (Groundhog Day) où la tradition veut qu'on observe la réaction d'une marmotte à la sortie de son terrier. Si elle en sort et ne voit pas son ombre (du fait des nuages dans le ciel), c'est signe que l'hiver finira bientôt. Au contraire, si elle voit son ombre (du fait du ciel dégagé), cela signifiera que l'hiver durera encore 6 semaines7.

*
 * *
 BONNE CHANDELEUR & BONNES "CRÊPES" & BONNE CHANDELEUR & BONNES "CRÊPES" &


| |
|
|
|
|
|
|
|
*Certes passée,mais les origines ne
16/01/2016 11:11


Épiphanie 2016 J-06 -- Janvier 2016
Longtemps, le 6 janvier (Epiphanie) fût plus important que le jour de Noël.
Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l'Epiphanie correspond à l'origine à une fête paienne.Autrefois, les Romains fêtaient les Saturnales. Ces fêtes duraient 7 jours et tout était autorisé. A cette occasion, les soldats tiraient au sort, grâce à une fève, un condamné à mort qui devenait "roi" le temps des réjouissances. Une fois les Saturnales achevées, la sentence était exécutée.
On avait également pris l'habitude d'envoyer des gâteaux à ses amis. Sous l'ancien régime, on l'appela "gâteau des rois" car cela tombait en pleine période des redevances féodales et il était d'usage d'en offrir un à son seigneur. Puis le concordat de 1801 a fixé la date de l'épiphanie au 6 janvier. Le terme "épiphanie" est issu du grec et signifie "apparition".
Célébrée le 6 janvier, cette fête correspond à la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages. Ce jour est aussi celui du premier miracle des noces de Cana et avant tout la date de baptême du Christ. Dès le Ve siècle, l'Eglise donna une importance considérable à cet événement. Pendant des siècles les chrétiens d'Orient célébrèrent la Nativité le jour de l'Epiphanie. Les Arméniens du Caucase le font encore aujourd'hui.
Au Ier siècle il fut déjà décidé de donner primauté à la naissance du Christ plutôt qu'à l'Epiphanie Dans de nombreux villages, on allume encore les "feux des rois" rappelant ceux qui, dit la légende, brûlèrent cette nuit-là à Bethléem pour cacher l'Étoile au roi Hérode.
En Espagne, c'est le jour de l'Epiphanie que les enfants recoivent les cadeaux et non à Noel. On profite de ce "Jour des 3 Rois" pour échanger les cadeaux de Noël puisqu'originellement, ce sont les rois mages qui apportèrent des présents 12 nuits après la naissance de l'enfant Jésus. Pour cette occasion, on confectionne un pain en forme de couronne parfumé de zestes de citron et d'orange, brandy et eau de fleur d'oranger, décoré de fruits confits et d'amandes effilées. On y glisse une pièce d'argent, une figurine chinoise ou un haricot sec.
La galette des rois,est une tradition typiquement française qui avait déjà cours au XIVe siècle. La galette était partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette portion supplémentaire, appelée "part du Bon Dieu" ou "part de la Vierge", était destinée au premier pauvre qui se présenterait.
LES ROIS MAGES
Venus d'Orient, trois rois se mirent en route en suivant la lumière de l'étoile qui les guida jusqu'à Bethléem. L'Épiphanie commémore la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter les présents à l'enfant Jésus, qu'ils appelèrent le " Nouveau Roi des Juifs ". Quand ils le découvrirent dans l'étable, près de ses parents, Marie et Joseph, ils s'agenouillèrent devant lui en signe de respect et lui apportèrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
  
L'origine des Rois mages est aujourd'hui encore obscure. On les dits savants, riches mais errants. Ces mystérieux personnages alimentèrent l'imaginaire qui enveloppe Noël.
MELCHIOR venait de Nubie, c'est le plus âgé des trois, il apporte de l'or, symbole royal.
BALTHAZAR apporte de la myrrhe, symbole sacerdotla. C'est une sorte de gomme produit d'un arbre en Arabie, le balsamier, utilisée dans la préparation cosmétique et en pharmacie.
GASPARD le plus jeune apporte de l'encens, symbole prophétique, c'est une résine dégageant un parfum lorsqu'on la fait brûler.
Dans l'Evangile de Matthieu 2:1-12, qui ne mentionne pas leurs noms, ils sont présentés comme des riches personnages ayant visité l'enfant Jésus à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode.
(L'Evangile de Luc 2:15-21 ne parle pas des mages ; par contre, il mentionne la visite des bergers.) Les rois mages, furent d'abord représentés comme des Perses. Un manuscrit grec, traduit en latin, révèle leurs noms, qui, plus tard, furent légèrement déformés et devinrent : Balthazar avec la peau cuivrée, Gaspard avec la peau foncée, et Melchior avec la peau blanche.
De même, on les fera paraître l'un imberbe, l'autre moustachu et le troisième barbu, leur attribuant ainsi les trois âges de la vie. Longtemps ce jour là, on célébra le miracle de Cana : de l'eau changée en vin. Un rituel de quête terminait jadis la période des 12 jours de fêtes. Les quêteurs recevaient souvent en guise de présent une part de galette.
Epiphanie
Origine de la fève et de la galette
La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins. Au début de janvier, les saturnales de Rome élisaient le roi du festin au moyen d'une fève. Si la tradition est d'origine religieuse, elle est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette. Celui qui trouvera la fève sera couronné roi ... et choisira sa reine.
En Angleterre, comme en Bourgogne, anciennement, on préférait former un couple "d'occasion" en mettant dans la galette une fève et un petit pois.
La part du pauvre
La première part est toujours la "part du pauvre", la "part de Dieu et de la Vierge" et elle était désignée par le plus jeune enfant de la famille. Il y avait aussi la part des absents - le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentrés. La part était rangée dans la huche jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire "on a pensé à vous". S'il se gardait longtemps, sans s'émietter et sans moisir, c'était un bon présage.

CLIC SUR LOGO : "JOYEUSE FÊTE.COM / LIEN DIRECT :
POUR SUITE / DOCUMENT - ORIGINE "L'EPHIPHANIE.
http://www.joyeuse-fete.com/epiphanie.html


 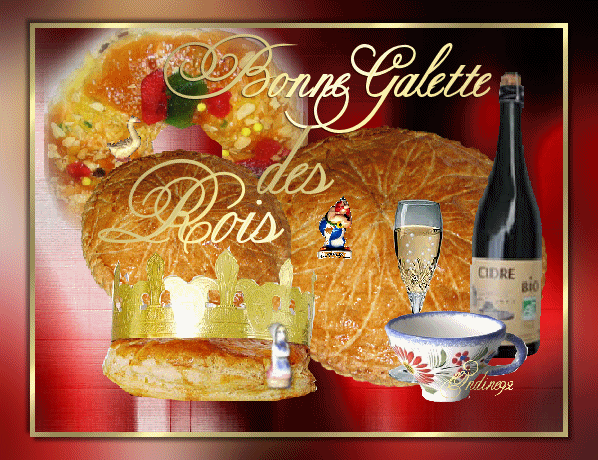


 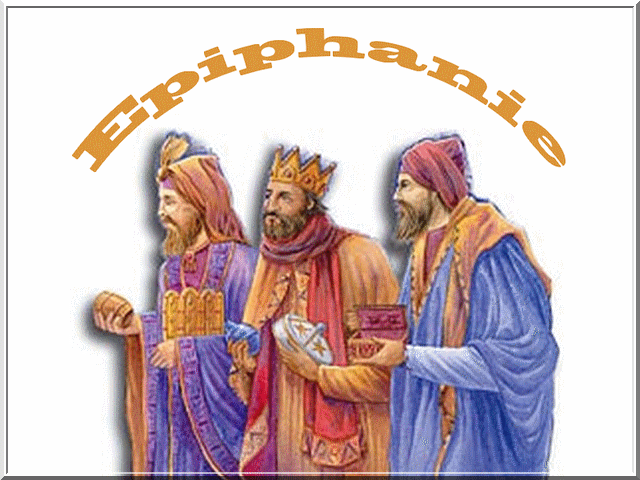
LES ROIS MAGES
Le terme "épiphanie" est issu du grec et signifie "apparition".
Célébrée le 6 janvier, cette fête correspond à la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages. Venus d'Orient, trois rois se mirent en route en suivant la lumière de l'étoile qui les guida jusqu'à Bethléem. L'Épiphanie commémore la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter les présents à l'enfant Jésus, qu'ils appelèrent le " Nouveau Roi des Juifs ". Quand ils le découvrirent dans l'étable, près de ses parents, Marie et Joseph, ils s'agenouillèrent devant lui en signe de respect et lui apportèrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
MELCHIOR venait de Nubie, c'est le plus âgé des trois, il apporte de l'or, symbole royal.
BALTHAZAR apporte de la myrrhe, symbole sacerdotal. C'est une sorte de gomme produit d'un arbre en Arabie, le balsamier, utilisée dans la préparation cosmétique et en pharmacie.
GASPARD le plus jeune apporte de l'encens, symbole prophétique, c'est une résine dégageant un parfum lorsqu'on la fait brûler. Origine de la fève et de la galette
La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins. Au début de janvier, les saturnales de Rome élisaient le roi du festin au moyen d'une fève. Si la tradition est d'origine religieuse, elle est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette. Celui qui trouvera la fève sera couronné roi ... et choisira sa reine. En Angleterre, comme en Bourgogne, anciennement, on préférait former un couple "d'occasion" en mettant dans la galette une fève et un petit pois.

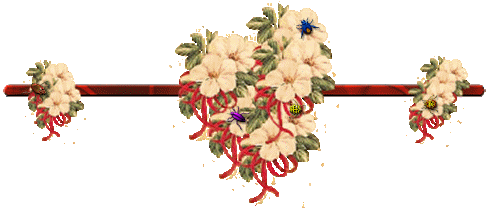
| |
|
|
|
|




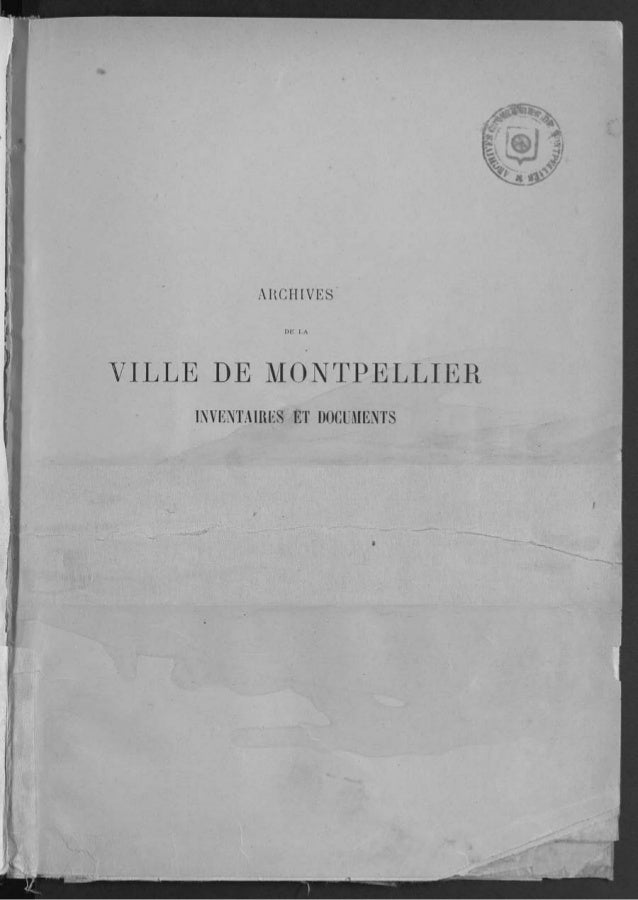

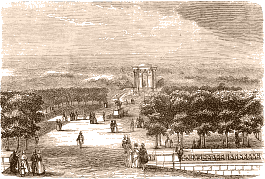











 Fête de la chandeleur : quand la religion rencontre les croyances populaires
Fête de la chandeleur : quand la religion rencontre les croyances populaires

 La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 février. Vous pouvez aussi consulter la
La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 février. Vous pouvez aussi consulter la