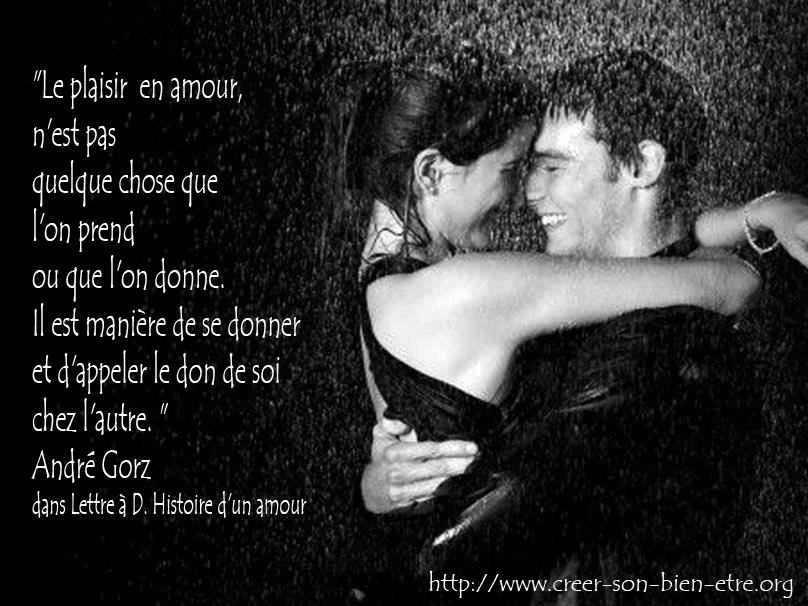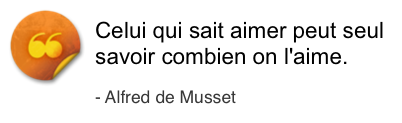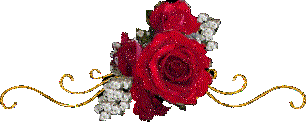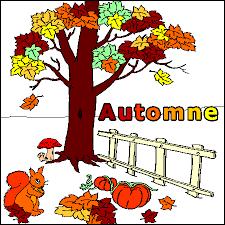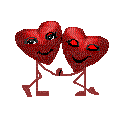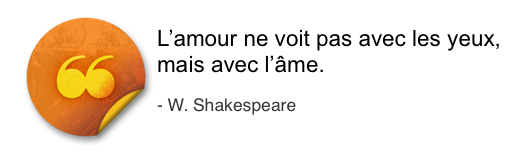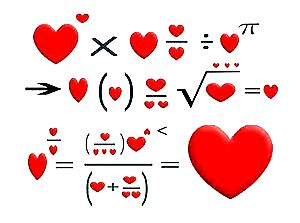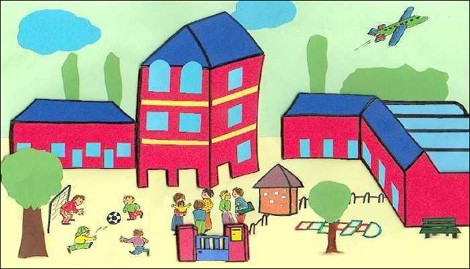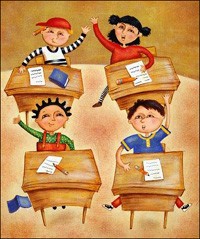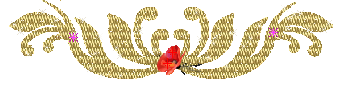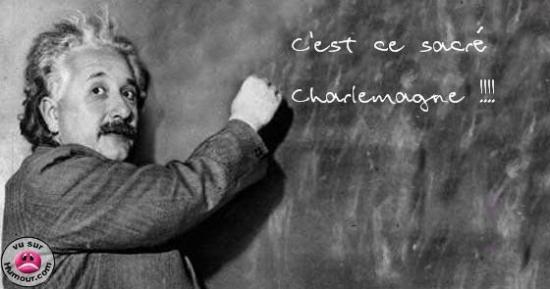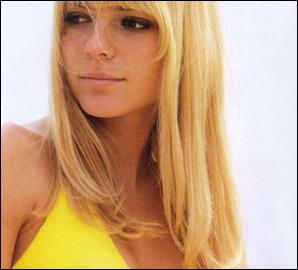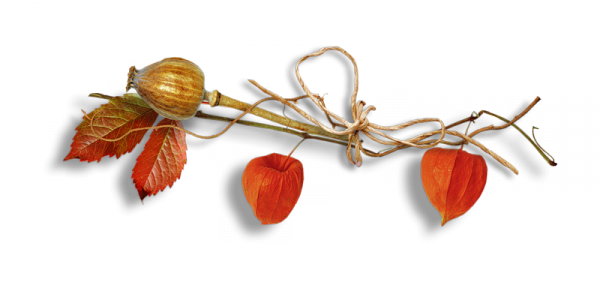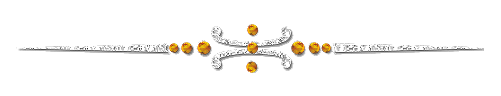L’amour c'est le beau, la douceur, la tendresse, la joie, le bonheur, l'apaisement, l'excitation, la paix, le plaisir, la patience, la tolérance, le pardon. Mais l'amour n'est jamais loin de la jalousie, de la haine, de la rancœur ou du désespoir. Quoi qu’on fasse, l’amour est partout et surtout, nous ne serions pas là, s’il n’existait pas!
Vers une définition de l’amour
Peut-on réellement définir ce qu’est l’amour? Théoriquement, oui. Les dictionnaires proposent une présentation assez succincte, définissant l'amour comme "un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose, qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité, pouvant être physique, spirituelle ou même imaginaire, avec l'objet de cet amour".
Mais dans les faits, nul ne pourra contredire le fait qu’il s’agit d’un mot recouvrant bien d’autres réalités, bien plus profondes, voire indicibles, d’où la difficulté, voire l’impossibilité d’apposer une réelle définition à ce terme intemporel. Néanmoins, il semblerait intéressant de prendre quelques instants de réflexion autour de ce terme qui, si l'on y réfléchit bien, est à l’origine de notre vie et même de notre monde.
L’amour: un sentiment riche et complexe
Selon nos propres convictions ou expériences personnelles, la nature même de l'amour est un sujet de débat, et plusieurs aspects de cette notion sont discutables. Autant, presque tous s’accorderont sur le fait que l’amour exprime un sentiment fort et positif, autant il devient parfois plus complexe de comprendre qu’on puisse l’associer à la haine, voire à l’indifférence. Pourtant, si l’amour est un sentiment complexe c’est bien parce qu’il a cette capacité d’éveiller en nous des émotions aussi fortes que contradictoires. Tantôt sentiment spirituel, tantôt sentiment physique, l’amour a ce pouvoir de s’associer à Dieu comme au désir sexuel. En tant que relation privilégiée et de nature romantique avec une personne, on le distingue souvent de l’amitié bien que cette relation puisse être définie comme une forme d'amour, et que certaines définitions de l'amour s'appliquent à une proche amitié.
Complexe, le verbe "aimer" renvoie à une grande diversité de sentiments, du plaisir abstrait lié à une chose ou une activité ("j’aime les bonbons", "j’aime le sport") à une véritable attirance voire dépendance à une personne (l’amour que l’on porte à son conjoint, à ses enfants…) Ainsi, Leibniz en donnait cette définition: "aimer, c'est se réjouir du bonheur d'autrui". Cette diversité d'emplois et de significations du mot le rend difficile à définir de façon claire et définitive.
Approche psychologique de l’amour
Si l’amour peut être tendresse, compassion ou désir, il peut aussi refléter le besoin de combler un manque. Ainsi, aimer serait une façon inconsciente d'avouer sa propre impuissance à être autonome. Besoin d’aimer ou besoin de se sentir aimer ne serait autre qu'un besoin égoïste, une attente de la personne qui pourrait combler les "manques" immatériels ou matériels que nous ne serions pas capables de satisfaire par nous-mêmes. Que seraient les joies, les bonheurs ou les souffrances de la vie s’ils n’étaient pas partagés? Ainsi, l’incapacité de vivre seul, ferait naître ce sentiment d’amour à l’égard de celui ou celle qui nous délivrerait de cette solitude.
Pour aller plus loin, le désir de faire un enfant, par exemple, serait motivé par le besoin de créer quelque chose bien à soi et de devenir nécessaire à la survie de quelqu’un. De plus, outre l’envie de continuer à exister à travers cet autre soi, le désir d’enfant sous-tendrait en fait un désir caché chez certains parents d'être accompagné vers la vieillesse. Là encore, il s’agirait d’un moyen d’éviter la solitude.
Dans cette approche, "aimer" serait une façon inconsciente de penser que la personne pour laquelle on éprouve des sentiments amoureux sera capable de nous apporter ce dont on a besoin.
Tant que l’on sent chez la personne aimée la présence des choses que l’on attend d’elle, le sentiment perdure, mais si la personne aimée perd ou ne dispose pas d'une partie de ce que l'autre attend, le sentiment d’amour s’estompe ou s’éteint. Lorsque ce sentiment s'estompe, il n'est pas rare d’entendre: "Nos deux chemins se sont séparés" car "mes besoins ont changé". La personne quittée ressentira alors probablement un sentiment de tristesse, de jalousie, de colère voire de haine. Comme quoi il ne peut y avoir de haine sans amour…
L’amour à travers l’art, la littérature et la philosophie
L'amour sous ses diverses formes joue un rôle majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Inspirant de nombreux artistes de toutes les disciplines artistiques, l’amour est un thème récurrent et majeur quelles que soient les époques, conséquence de la naissance, de la vie et la mort.
En effet, comment parler d’amour sans évoquer les grandes histoires d’amour de la littérature comme Roméo et Juliette, couple emblématique de l’amour passionnel, la légende de Tristan et Yseult, ou bien encore les divinités mythologiques à l’instar de Cupidon, dieu des amours profanes et Aphrodite, déesse de l’amour. Il semblerait également que ce soit par le biais de la littérature que le thème de l'amour ait été traité par les philosophes. Pensons à Rousseau, Goethe, Voltaire, etc.
De l’idéal "vivre d'amour et d'eau fraîche" rêvé par certains, à l’idyllique "Peace and Love", ces expressions universelles placent l’amour au centre de la vie, comme unique nécessité, un plaisir de la non-violence, de la séduction et des divertissements sexuels.
Ainsi, l’amour est partout. A l’origine de notre vie, il nous fait naître, vivre et parfois mourir. Dictateur, totalitaire, l’amour apparait comme un sentiment puissant sur lequel nous n’avons pas d’emprise. Le poète Virgile avait peut-être raison en déclarant que finalement "l’amour triomphe de tout".