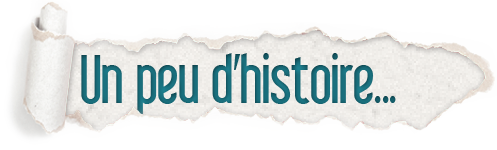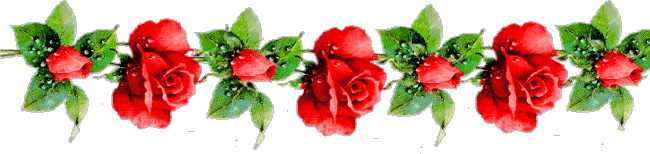L’école à contretemps
Se retourner vers le passé met le présent en perspective et permet de mieux comprendre, de mieux apprécier l'éventuelle nouveauté des difficultés et d'envisager quelles solutions on pourrait leur apporter. Mais il faut bien distinguer le secondaire et le primaire. Les vacances concernent d'abord exclusivement le secondaire.
Les vacances :
Un fait social et non scolaire
Le Collège et le Lycée
Bien évidemment, Louis XIV n'a pas inventé les vacances scolaires. Mais il a domestiqué l'aristocratie en créant la Cour : en France, mais pas en Angleterre, les nobles ne doivent pas travailler. Produire, commercer, c'était indigne d'eux : c'était « déroger », manquer à son rang. D'où un mode de vie oisif, caractérisé par l'alternance entre la mauvaise saison, où les nobles résident en ville, dans leur hôtel particulier, et la bonne, où ils séjournent dans leur château à la campagne pour surveiller leurs fermiers. Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur.
La Révolution a supprimé les privilèges, mais la noblesse a gardé son prestige social. La bourgeoisie l'a imitée, elle a cherché à « Vivre noblement », c'est-à-dire à vivre de ses rentes, sans travailler. Elle a adopté le mode de vie de l'aristocratie. Prendre des vacances, c'était montrer qu'on n'avait pas besoin de travailler. C'était se distinguer du peuple besogneux qui devait gagner son pain quotidien. Les bourgeois ont donc acheté des maisons à la campagne pour y passer leurs vacances. Aujourd'hui encore, le phénomène social des résidences secondaires occupe en France une place beaucoup plus grande que dans les autres pays d'Europe : près de 10% des logements (2 583 000) sont des résidences secondaires. 42,3% des membres des professions libérales en possèdent une, 28,5% des cadres et 33,8% des indépendants et retraités. Plus du quart des cadres et professions intellectuelles supérieures passe ses vacances dans une résidence secondaire, personnelle ou familiale. Seules 9 % des familles partent en vacances à la neige.
Au XIXe siècle, les enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie étaient pratiquement seuls à fréquenter les lycées et les collèges publics ou privés[1] ; ils rejoignaient donc leur famille en été, pour participer non à la moisson, ni même aux vendanges, mais aux réseaux de sociabilité qui se nouaient alors, notamment autour de la chasse. La chasse est noble : sous l'Ancien Régime c'était le privilège du seigneur. Le permis de chasse sera une conquête de la démocratie. Les vacances allaient donc du 15 août au 1er octobre.
Il n'y avait pratiquement pas de petites vacances, car la moitié au moins des élèves étaient internes, et cela prenait beaucoup de temps, sans chemins de fer ni automobiles, pour aller du collège à la maison et en revenir, surtout en hiver. En outre, le voyage coûtait cher. L'entreprendre pour quelques jours n'en valait pas la peine. Pour Pâques seulement, la fête religieuse la plus importante, il y avait 6 jours de vacances. Mais souvent après la fête, car le clergé et les congrégations se méfiaient de la manière dont les familles la célébraient et ils préféraient que les élèves se sanctifient au collège sous leur contrôle.
Tout au long du XIXe siècle, les vacances vont « remonter » dans l'année.
En 1875 : elles commencent le 9, puis en 1891 le 1er août. Il y a alors deux rentrées : celle d'octobre et celle de Pâques. C'était une vraie rentrée, car il restait environ 4 mois de classe avant les « grandes vacances ». La tradition survivra très avant dans le XXesiècle pour les classes élémentaires des lycées. Les recteurs disposaient en outre de 8 jours de congés à donner aux élèves quand ils le jugeaient bon.
En 1912 : les vacances courent du 14 juillet au 1er octobre.
En 1925 : 2 semaines à Noël et 2 semaines à Pâques
Durant le Front Populaire, Jean Zay supprime les jours de congé à la discrétion des recteurs, et il institue une coupure supplémentaire dont sortiront les vacances de février et celle de Pentecôte. A ce moment là, c'est soit les unes, soit les autres. Pâques change de date tous les ans. Si Pâques est tard, le second trimestre est trop long, et J. Zay prévoit alors 4 jours de vacances en février, à Mardi Gras ; si Pâques est tôt, il donne 4 jours à Pentecôte pour couper le troisième trimestre qui se termine alors le 14 juillet.
En 1959 : André Boulloche, ministre socialiste de De Gaulle, déplace le début des grandes vacances du 15 au 1er juillet. Elles se terminent à la mi-septembre et durent donc deux mois et demi. Le premier trimestre s'allongeant, 4 jours sont libérés autour de la Toussaint.
1972, après les jeux olympiques d'hiver de Grenoble, le tourisme de station de sport d'hiver se développe ; les vacances d'hiver sont instituées. Le zonage (A,B,C) est créé pour les vacances d'hiver et de printemps afin de favoriser le développement de l'économie du tourisme et de limiter les embouteillages.
En 1983, on réduit les vacances d'été aux deux mois de juillet-août pour mieux fournir les « petites vacances ».
En 1986, le rythme 7 semaines de classe / 2 semaines de vacances est expérimenté et abandonné l'année suivante. Le système des trois zones, indispensable à l'industrie touristique, le perturbe trop.
L'école primaire
Le système éducatif français a été fondé à partir du lycée (qui allait du jardin d'enfants au baccalauréat). C'est lui qui intéressait l'Etat, pour former ses cadres administratifs et techniques. Le primaire concernait les autorités de proximité, maire et curé. L'école primaire s'est donc organisée selon une toute autre logique, avant que la convergence progressive des deux systèmes n'aligne le primaire sur le secondaire, plus prestigieux.
Contrairement à une idée courante, les vacances n'ont pas été instituées pour permettre aux enfants des paysans d'aider leurs parents aux foins et à la moisson. La raison est simple. Les vacances ont été faites pour ceux qui allaient à l'école et seuls les enfants de la bourgeoisie allaient vraiment à l'école. Au XIXème, les petits paysans et ouvriers vont en classe quand ils n'ont rien de mieux à faire. Ce qui est normal, en quelque sorte, ce n'est pas qu'ils soient en classe, c'est qu'ils soient ailleurs, occupés à aider leurs parents. La question n'est pas de savoir quand il faut leur donner des vacances, c'est de les faire venir. Tout au long du XIXème et dans la première moitié du XXème, après même l'instauration de l'école gratuite pour tous, le grand problème des instituteurs c'est la fréquentation scolaire. Les élèves arrivent après la Toussaint, et ils commencent à s'absenter quand reviennent les beaux jours. Les classes ne sont au complet que pendant quatre ou cinq mois. Le reste de l'année, ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont présents, d'où une difficulté pédagogique réelle, tous n'ayant pas suivi les mêmes leçons. Il faudra un effort qui prendra des générations, pour grignoter l'absentéisme scolaire et rendre la fréquentation plus régulière et plus longue. Les républicains en font l'un des axes de leur politique, car pour eux l'école est le fondement même de la République. Malgré tout, il reste des enfants qui ne fréquentent jamais l'école et ceux qui la fréquentent, le font de manière irrégulière, après comme avant les lois de Jules Ferry. En 1954 encore, certains préfets de régions agricoles « permettaient » aux enfants de 9 ans de ne pas aller à l'école pour faire les vendanges...régime « très » dérogatoire puisque « la loi du 22 mai 1946 stipule que des dérogations concernant les dates de rentrée ne peuvent être accordées, pour des travaux agricoles, qu'à des enfants de 12 ans et plus ».
L'idée de vacances n'était pas mieux adaptée aux instituteurs. Jusqu'à la gratuité, élargie en 1867 et obligatoire en 1862, une partie importante de leur rémunération venait de l'écolage, le droit que payaient les parents chaque mois pour mettre leur enfant à l'école, souvent 1 franc pour apprendre à lire, 1,50 à lire et à écrire, et 2 pour apprendre en plus à compter. Les parents ne payaient pas quand ils n'envoyaient pas leur enfant à l'école. Pour les instituteurs, l'absentéisme représentait un manque à gagner sensible. Des vacances eussent été une coupe sombre.
En 1834, les écoles ferment un mois dans l'année. Ce mois est arrêté par le préfet qui, selon la situation de son département, choisit le moment opportun ; généralement un moment où l'on est sûr que les élèves ne seront pas présents. En revanche, les jours ponctuels de congé sont fixés par l'Etat. Par un strict effet de miroir inversé entre l'école du peuple et celle des notables, le temps des longues vacances est normé pour ceux qui dirigeront le pays et laissé à l'appréciation du pouvoir local pour la masse ; inversement, les jours isolés sont organisés au plan local pour les lycées et au plan national pour les écoles. Est-ce une curiosité signifiante ?
En 1860, une semaine de vacances est décidée à Pâques.
En 1874, il y a 4 semaines de vacances pour la maternelle (voire 2 ou même 0), 6 semaines pour le primaire, 8 pour le primaire supérieur et les écoles normales.
En 1877, début d'un « réflexe » que l'on retrouvera par la suite : on donne du temps aux instituteurs en lieu et place d'un supplément de salaire. Les vacances sont une récompense. On donne deux semaines de plus aux instituteurs qui font des cours d'adultes en plus de leur classe.
Après la Première Guerre mondiale, la fréquentation est meilleure, et la différence entre primaire et secondaire commence à choquer. En 1922, on ajoute quinze jours au mois et demi de vacances d'été.
En 1939, après une expérimentation l'année précédente, Jean Zay, dans un même arrêté pour le primaire et le secondaire fixe les mêmes vacances pour tous les enfants quel que soit leur milieu. La date est lourde de sens : le Front populaire vient d'instituer les congés payés. C'est une conquête démocratique majeure, car elle donne aux ouvriers un droit aux vacances dont la bourgeoisie bénéficiait en quelque sorte de naissance. La bourgeoisie s'est indignée de cette mesure ; la Vie ouvrière, non sans gouaille, se moque des bourgeois irrités de voir les ouvriers envahir « leurs » plages ou surcharger « leurs » trains. Dès lors que tout le monde a droit aux vacances, il n'y a plus de raison d'avoir deux régimes différents pour les écoles et pour les lycées. Et il est bon que les enfants soient en vacances au même moment que leurs parents.
Comme décrit plus haut, les petites vacances sont instituées et prendront de plus en plus de place dans un système unifié.
De la semaine à la petite semaine
Contrairement à ce qu'on entend souvent, le jour sans classe du jeudi n'a pas été inventé en 1882 pour permettre l'enseignement du catéchisme quand on a décidé que l'école serait laïque. L'origine du jeudi est très ancienne. Elle remonte à l'Ancien Régime. En 1810, les frères des écoles chrétiennes ne font pas classe le jeudi après-midi. Le jeudi est totalement libéré en 1858 dans le primaire. Rien ne change sur ce point avant 1968. Pendant près d'un siècle, les écoliers ont eu 30h de classe (6h x 5jours) par semaine, mais il est vrai que beaucoup ne venaient pas tous les jours.
Dans les années 1960, la fréquentation est régulière. En mars 1968, le grand colloque d'Amiens « Pour une Ecole nouvelle » insiste sur la nécessité de libérer du temps de formation continue pour les enseignants. Sur ce, éclatent les événements de mai-juin, qui favorisent des mesures sociales. En 1969, le ministre réduit la semaine des écoliers de 30 h. à 27, en dégageant les trois heures du samedi après-midi pour la formation permanente des instituteurs. C'était cousu de fil blanc. Il fallut peu de temps pour que le samedi après-midi soit entièrement libéré, la formation permanente des maîtres étant organisée dans un autre cadre, plus efficace.
Du coup, la semaine devenait déséquilibrée : du lundi au mercredi 6 demi-journées de classe, jeudi repos, vendredi et samedi matin classe, soit 3 demi-journées. On a donc décidé en 1972, de rééquilibrer la semaine, en déplaçant le jour de repos du jeudi au mercredi. Ce qui donne 4 demi-journées, suivies de 5 demi-journées.
En 1989, Lionel Jospin institue les projets d'école. Ils nécessitent des réunions qui s'ajoutent à celles des conseils d'écoles, des conseils de maîtres et de cycles. Pour compenser les heures supplémentaires ainsi faites par les maîtres, le ministre diminue leur obligation de service qui passe de 27 à 26 heures par semaine. Dans la pratique, cela se traduit par la suppression d'un samedi matin de classe toutes les trois semaines. Là encore, ces heures se feront dans la semaine et rarement le samedi libéré. L'école s'organise aussi en cycles de trois années qui remplacent les classes (cycle 1 : maternelle ; cycle 2 : grande section, CP, CE1 ; cycle 3 : CE2, CM1, CM2) afin de permettre à chaque élève d'effectuer le cycle à son rythme (entre 2 et 4 ans).
En 1990, le ministère autorise les inspecteurs d'académie à expérimenter de nouvelles organisations hebdomadaires. Dans ce cadre, on constate en 1998 que la semaine de 4 jours est adoptée dans un quart des écoles, avec, pour compenser cette réduction de la semaine, un allongement de l'année scolaire (une semaine en été et quelques jours sur les petites vacances). L'organisation n'est pas la même dans tous les départements, ni parfois, dans un même département, entre toutes les communes. Le choix local et la concertation entre acteurs priment sur les directives nationales.
En 2008, la semaine à quatre jours, avec le même calendrier pour toute la France, avec est imposée, et la compensation d'une réduction des vacances supprimée.
Le bilan de ces évolutions est impressionnant. Aujourd'hui, il y a en principe 16 semaines de vacances et 36 semaines de classes. Mais il faut retirer le 11 novembre, le 1ermai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension, le lundi de Pentecôte. C'est en France, surtout après le passage à 4 jours, qu'il y a le plus petit nombre de jours de classes (moins de 140 contre 180 à 200 pour les autres pays européens) pour un nombre d'heures assez élevé (840h contre autour de 800 dans les pays scandinaves).
Histoire d'Heures
La journée de classe est de six heures depuis très longtemps. En 1887, on décrète qu'il y aura 3h de classe le matin et 3h de classe l'après-midi. Pourtant, l'évolution de l'année et celle de la semaine conjuguent leurs effets pour entraîner une très forte diminution du nombre total d'heures de classe.
1939 1128 h
1968 1088 h
1969 975 h
1981 942 h
1998 888 h
2008 840 h
Il s'agit ici d'un nombre d'heures théoriques, obtenu en multipliant le nombre de jours de classe par 6. Ce résultat est sensiblement supérieur à la réalité, car les récréations font partie des 6 heures quotidiennes. Or elles se sont elles-mêmes allongées et elles durent actuellement en moyenne 49 minutes par jour. Presque une heure.
L'industrie réussit à augmenter sa production tout en réduisant la durée du travail parce qu'elle réalise des gains de productivité, grâce à de nouvelles techniques, de nouvelles machines, une meilleure organisation. Mais où sont les gains de productivité dans l'enseignement ? Existerait-il une méthode miracle pour que les enfants apprennent à lire aussi vite qu'avant tout en y passant moins de temps ? Les enfants sont-ils plus intelligents aujourd'hui qu'hier ? Il faudrait qu'ils le soient beaucoup, pour qu'un enseignement aussi diminué conserve son efficacité. Comment pourrait-on apprendre plus et mieux en travaillant moins ?
En outre, l'appel incantatoire aux vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves est absurde : rien ne prouve que ces méthodes massivement répétitives, efficaces avec 1100 heures de classe par an, puissent l'être autant avec 840. On retourne à des méthodes qui exigent beaucoup de temps, alors même qu'on diminue le temps pendant lequel on les applique.
Si le nombre est important, la qualité des heures de cours l'est tout autant. Or toutes les heures de cours ne se valent pas. On sait que la première demi-heure matinale est peu rentable. On constate un pic d'attention vers 10 h. 30-11 h. au CP, plus tard en CE et un peu plus tard encore en CM. Le début d'après-midi enregistre un creux d'attention, qui n'est pas dû à la digestion comme on le croit, car on le constate dans des sociétés où le repas de midi est très frugal. La reprise est plus tardive pour les petits que pour les grands. On sait aussi depuis cinquante ans que la capacité de travail utile des enfants varie avec l'âge, passant de 3 h ½-4 h. par jour à 6-8 ans, à 5 h. pour ceux de 12 ans. Notre organisation uniforme, indépendante des âges, est proprement stupide. C'est comme donner systématiquement des biberons de 200 grammes de lait à tous les nourrissons, quel que soit leur âge.
En outre, le découpage en heures de cours est absurde. Traditionnellement, l'enseignement primaire s'organisait en séquences de 20 minutes. Les enfants de 6-7 ans ont une capacité d'attention soutenue de l'ordre de 15 minutes. Sur des séquences de 15 minutes, on constate que les enfants de 6 ans ont deux fois plus de minutes d'attention que ceux de 5 ans. L'organisation du temps scolaire devrait donc s'adapter avec souplesse. Or on n'en tient pas compte.
Dans le secondaire, la rigidité est étonnante. Au XIXème siècle, la classe durait deux heures. Le passage à des séquences d'une heure, en 1902, a rencontré une forte résistance. Mais, maintenant, c'est la séquence d'une heure qui résiste. R. Haby avait essayé de passer à des séquences de 45 minutes en 1975, il a du renoncer.
Le collège de Clisthène à Bordeaux, montre qu'il est à la fois possible et efficace d'organiser autrement le temps scolaire, tout en respectant les volumes horaires réglementaires. Il a supprimé les interclasses, ce qui gagne du temps et du calme : ce sont les professeurs qui changent de classe, pas les élèves. La demi-heure ainsi gagnée est consacrée à un temps d'accueil sans cours, de 8 h ½ à 9 h. Les expériences ont montré en effet que cette première demi-heure est d'un rendement scolaire très faible. De 9 h à midi, les 3 heures de classes sont coupées en deux séquences d' 1 h. ½ chacune. Qui peuvent elles-mêmes se couper en deux : les professeurs de langues préfèrent en effet des séquences plus courtes, mais plus nombreuses, 4 séquences de ¾ d'heures plutôt que 3 d'une heure. L'après-midi, les 2 h. de cours sont organisées en atelier, ou coupées en deux séquences d'1 h. Bien d'autres combinaisons sont possibles. Le découpage en heures est une simplification créatrice d'uniformité. Elle met en équivalence des disciplines dont les contraintes et l'intérêt sont structurellement différents.
En conclusion,
les temps scolaires ont toujours été des temps sociaux, organisés en fonction des modes de vie de la bourgeoisie et du peuple. Les nécessités pédagogiques n'ont pas souvent été prises en compte, ni les capacités d'attention des élèves. Les raisons économiques ont eu à plusieurs reprises un fort impact sur les décisions prises, notamment dans les années 1970 pour le développement du tourisme. Les raisons politiques ont, elles aussi, fortement constitué les temporalités de l'école (à la naissance de la troisième République et au Front populaire). Les « moments » de l'Histoire qui ont vu mettre l'enfant comme première préoccupation dans une réforme sont rares. Le premier fut la circulaire du 29 décembre 1956 qui interdisait les devoirs et encadrait les études du soir. Elle prenait en compte « les études récentes sur les problèmes relatifs à l'efficacité du travail scolaire dans ses rapports avec la santé des enfants ». On sait ô combien il est difficile de faire appliquer cette circulaire. Le second moment fut en 1986 avec l'adoption du rythme 7 semaines de classe et 2 semaines de vacances qui ne vécu qu'un an. Le troisième fut l'ensemble des lois de Jospin en 1989 : l'organisation par cycles n'a jamais pris corps dans les écoles.
Aurons-nous à l'avenir un projet pensé pour les élèves et les enfants ? Ce projet doit-il être imposé nationalement ou doit-il trouver une réalisation concrète et locale comme ici à Lodève ? Cela ne dépend que des acteurs de l'école.
Ce compte rendu de la conférence du 21 janvier a été rédigé par moi-même. Il a été revu par Antoine Prost. Sébastien Rome.
Antoine Prost, est histoirien, spécialiste de la France au XXe siècle (société et mentalité) et des questions d'éducation.
L'intervention, à cette même conférence, de Dominique Momiron suivra cette publication dans quelques jours.
[1] Attention : les collèges d'alors ne vont pas comme aujourd'hui de la 6ème à la 3ème. Ce sont des établissements secondaires comme les lycées, qui vont du jardin d'enfant ou de la 10ème au baccalauréat.
Sébastien Rome
C:\Users\christophe\Desktop\l-ecole-contretemps.htm


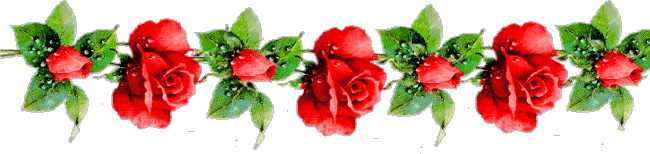


















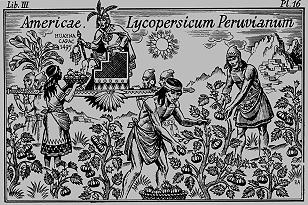
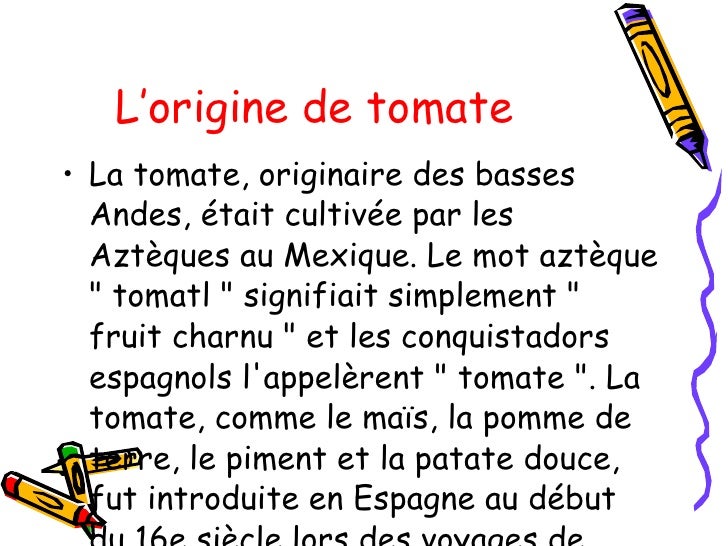
 Il existe sans doute des milliers de plats à base de tomates. En raison de sa couleur, de son goût et de ses nombreuses variétés, la tomate a parcouru un long chemin depuis les anciennes civilisations aztèques pour devenir omniprésente dans les cuisines d'aujourd'hui.
Il existe sans doute des milliers de plats à base de tomates. En raison de sa couleur, de son goût et de ses nombreuses variétés, la tomate a parcouru un long chemin depuis les anciennes civilisations aztèques pour devenir omniprésente dans les cuisines d'aujourd'hui.